Fabrice Loi
Gallimard, 2015
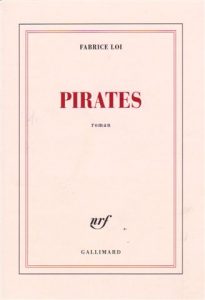 Le roman de Fabrice Loi liste d’abord les innombrables horreurs de la planète, lesquelles se croiseront pour en tisser l’intrigue : l’Afrique ravagée subissant les interventions armées de puissances extérieures, les déchets nucléaires de la planète à enterrer dans des « trous » somaliens en échange de livraisons d’armes, etc… Bref, s’esquisse d’emblée un monde où « vertueux et salauds » font prospérer leur « fonds de commerce » (c’est-à-dire l’Occident face aux bandits africains) ! Un roman, annoncé comme tel, ne l’est pas tout à fait. Il est en outre un révélateur/ dénonciateur des désordres actuels du monde, animé par une colère politique sous-jacente. Une ville, Marseille avec sa fulgurance chaotique, imprègne largement le récit.
Le roman de Fabrice Loi liste d’abord les innombrables horreurs de la planète, lesquelles se croiseront pour en tisser l’intrigue : l’Afrique ravagée subissant les interventions armées de puissances extérieures, les déchets nucléaires de la planète à enterrer dans des « trous » somaliens en échange de livraisons d’armes, etc… Bref, s’esquisse d’emblée un monde où « vertueux et salauds » font prospérer leur « fonds de commerce » (c’est-à-dire l’Occident face aux bandits africains) ! Un roman, annoncé comme tel, ne l’est pas tout à fait. Il est en outre un révélateur/ dénonciateur des désordres actuels du monde, animé par une colère politique sous-jacente. Une ville, Marseille avec sa fulgurance chaotique, imprègne largement le récit.
Mais qui sont donc les « pirates » de son titre ? D’abord des nomades qui sont vus ainsi, « alors qu’ils veulent vivre comme ils veulent ». Le roman démarre vraiment – en pulsation, ouf – lorsque Tony Palacio le « crasseux », travaille dans un garage (mais lit Neruda et joue de la trompette). Ce gitan baise une fille à talons hauts sur un siège de Fiat, puis remonte de nuit une DS, mais le patron néglige de mettre un cric sous la carcasse qui… l’écrase. Il cogne ensuite sur Le Gordo, lequel refuse de lui payer son travail, puis récupère son dû de 1 000 €. Il vit en colocation avec d’autres paumés. Il est pris en un engrenage.
En jouant de la trompette en bord de mer, cet « art qui parle au cœur » (il dira un « coeur-trompette »), il est entendu et invité par Max Opale, un homme que « la finitude travaille ». Lui qui n’aime que « les purs », pénètre dans le monde des riches, non sans suspicion. Max, soldat ambigu et expert en balistique, dispose d’échantillons radioactifs. Il lui propose un travail car il est « inconnu », quelqu’un « de frais » ! Chez lui, le « Don Juan de garage (…) azimuté » – découvre Awa, l’orgueilleuse sudafricaine à la voix éblouissante. Il veut d’emblée la conquérir, avant de prendre conscience qu’il doit la « fuir ». Dans cet univers en zigzag, Tony revient vers Max qui explique sa contestation politique, et éclaire les activités d’autres « pirates », cette fois de Somalie… Il justifie leur action, cachée au grand public : une terre dévastée, une côte pillée par des bateaux de pêche illégaux et polluée par les décharges nucléaires et toxiques (de France, d’Italie, etc…), un peuple affamé atteint d’effroyables maladies… Cet univers complexe, effroyablement morcelé, est très proche de la réalité. Tony finira pris au piège.
Au fil de ce faux roman (*), des pensées éparses reflètent un idéal. « Toutes les villes sont miennes », dira ainsi Hykmet le stambouliote. Ailleurs, un constat évoque les rapports entre hommes : «S’ils t’ignorent quand tu approches ta main, c’est qu’ils ne s’aiment pas eux-mêmes ». Il faut voir là la raison de ce « roman » – réponse ou explication – dédié au final à ces deux journalistes assassinés lors de leur enquête à Mogadiscio.
Il est vrai que le texte aurait gagné en puissance s’il n’avait pas cherché parfois à trop dire, à explorer tant de ramifications. L’auteur n’est jamais aussi captivant que lorsqu’il s’abandonne à son émotion (tempête en mer, désert, écoute d’un opéra) et joue une partition littéraire qui tient du free jazz.
Jane Hervé
(*) Au sens où il porte moins de fiction que de réel.
